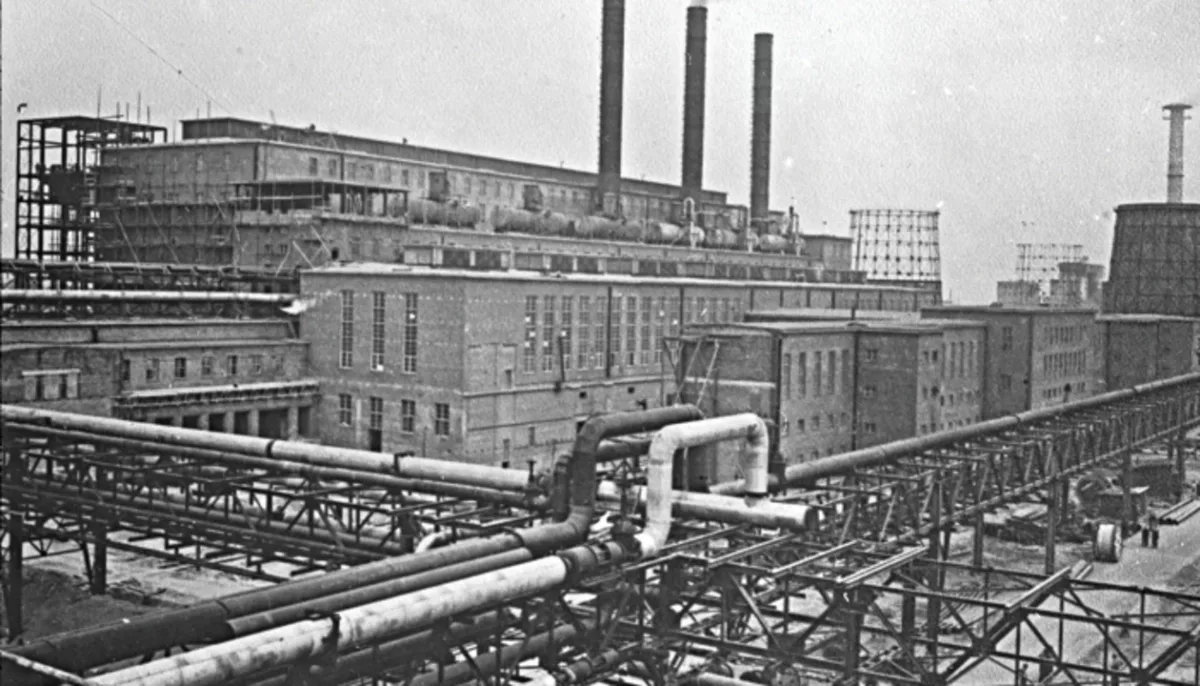Le texte ci-dessous est la retranscription, légèrement remaniée, d’un entretien entre Romaric Godin et Robert Ferro qui a eu lieu le 11 octobre 2025 au DOC! à l’occasion des 10 ans des éditions La Tempête — qui venaient de publier Industrie et national-socialisme de Sohn Rethel. Un membre de celles-ci en assurait la modération. L’appareil de notes a été rédigé par la rédaction à l’occasion de cette publication.
Robert Ferro
Sohn-Rethel a à peu près 30 ans quand il achève son doctorat en économie et soutient sa thèse en 1928. Cette thèse opère une critique de l’économie néo-classique et marginaliste en s’appuyant sur des notions et concepts issus de l’économie industrielle et des sciences de la gestion, telles que la distinction entre coût variable et coût fixe, ainsi que certaines notions associées à l’économie d’échelle telle que celle de taille minimale optimale. Ces concepts et notions sont également très présents dans Industrie et national-socialisme.
Après, donc, avoir discuté sa thèse de doctorat en 1928, et après une période de cinq-six ans comprise entre 1921 et 1927, où il vit un peu à Berlin et un peu à Naples, Sohn-Rethel renonce à entreprendre une carrière universitaire et atterrit dans un milieu qu’aujourd’hui on qualifierait de milieu de think-tanks, de bureaux d’étude et de consultants, qui travaillent pour les associations patronales allemandes. Et c’est dans ce contexte que Sohn-Rethel fait trois expériences professionnelles décisives, trois expériences qui se recouvrent en partie temporellement, étant toutes comprises entre 1931, la dernière phase de la République de Weimar, et la première phase du régime National-Socialiste : 1931-1936, donc, car Sohn-Rethel quitte l’Allemagne, fuit, en 1937.
La plus importante de ces expériences professionnelles se déroule au sein d’un cabinet d’études économiques qui s’appelle Mitteleuropäische Wirtschaftstag, autrement dit Conseil pour l’Économie Centre-Européenne, abrégé MWT. MWT qui va jouer, d’après ce que Sohn-Rethel raconte dans ce livre, un rôle crucial dans l’élaboration d’une stratégie allemande, à la fois économique et géopolitique, pour l’Europe centrale et l’Europe orientale. Cette stratégie se met déjà en place en ces années de République de Weimar déclinante, et va évidemment continuer de façon très renforcée sous le national-socialisme.
La deuxième expérience, en ordre d’importance, est celle qui le voit participer à la rédaction des Deutsche Führerbriefe, une lettre d’information confidentielle réservée aux hautes sphères de l’industrie, de la finance et de l’armée. Les journalistes et la presse sont, soit dit en passant, exclus de cette sphère confidentielle. La publication de cette lettre a lieu elle-même à cheval entre la fin de la République de Weimar et le début du national-socialisme1Plus précisément, entre 1929 et 1935..
La troisième expérience, plus tardive, se déroule au sein d’une chambre de commerce allemande pour l’Égypte, qui opère dans le cadre de ce qu’on appelle le clearing, ou système de clearing nazi. Je n’ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais il se trouve qu’après la crise de 1929, l’Allemagne se trouve soit dans l’impossibilité, soit on va dire dans une situation où il est préférable de renoncer à l’usage des devises clefs que sont le dollar et la livre sterling dans les transactions internationales. Cette contrainte engendre une autre manière de gérer les échanges internationaux qu’est le clearing2Adam Tooze résume le principe de ce système de compensation dans Le Salaire de la destruction (Les Belles lettres, 2012, pour la traduction française) :
« Normalement, bien sûr, les fournisseurs privés de France, de Belgique ou des Pays-Bas auraient rechigné à continuer de livrer des produits à un client étranger qui avait des dizaines de milliards de Reichsmarks de factures impayées. Depuis les années 1930, cependant, les systèmes de compensation de la Reichsbank avaient été conçus pour éliminer ce genre d’obstacles. Les exportateurs de chaque pays étaient payés, non pas par leurs clients en Allemagne, mais par leurs propres banques centrales, dans leur propre devise. La banque centrale étrangère inscrivait alors le déficit au compte de compensation de l’Allemagne à Berlin. Les Allemands recevaient leurs produits, les fournisseurs étrangers étaient payés sans tarder, mais le compte n’était jamais réglé. Fin 1944, la Reichsbank devait près de 30 milliards de Reichsmarks aux membres du système de compensation, dont 8,5 à la France, le principal créancier commercial de l’Allemagne, et 6 aux Hollandais, 5 à la Belgique et au Luxembourg et 4,7 à la Pologne. Bien que ce système permît à l’Allemagne un important déficit commercial net – autrement dit, une entrée de biens et de services qui n’était pas contrebalancée par les exportations allemandes –, il serait trompeur de suggérer que le commerce au sein de l’empire nazi était à sens unique. En réalité, les exportations allemandes se poursuivirent à un rythme fâcheusement élevé tout au long de la guerre. ».
De ces trois expériences, Sohn-Rethel tire une connaissance fine des antagonismes internes au grand capital allemand. Une connaissance qui est restituée dans Industrie et National Socialisme. Les matériaux qui composent le livre ont été rédigés entre 1937 et 1938 – en Angleterre, après la fuite de Sohn-Retel d’Allemagne.
Ils sont le résultat d’exposés, conférences et autres notes de synthèse que Sohn-Rethel présente dans les cercles intellectuels du parti conservateur anglais, en particulier auprès du courant incarné par la figure de Winston Churchill, qui s’oppose à la ligne de Neville Chamberlain qui prédomine au cours des années 1930, c’est-à-dire la ligne de l’apaisement. On peut supposer, en tout cas c’est ma supposition, que cette collaboration politique avec la droite anglaise, contrairement aux dires mêmes de Sohn-Rethel dans ce livre, n’a pas été motivée exclusivement par ses préoccupations antifascistes, mais aussi par la volonté, de, disons, se faire bien voir par les autorités britanniques, dans une phase historique où l’immigration vers les États-Unis devient de plus en plus compliquée.
Pour rappel, alors que tous les intellectuels, ou en tout cas un grand nombre d’intellectuels qui se rattachent de près ou de loin à l’école de Francfort, arrivent à se sauver et à rejoindre les États-Unis, Sohn-Rethel reste coincé en Angleterre.
Quoi qu’il en soit de cette supposition, ces écrits ne seront repris par Sohn-Rethel et remis en chantier, réordonnés, qu’au début des années 70, pour être enfin republiés en Allemagne en 1973 par l’éditeur Zürkamp avec un titre qui diffère de cette édition, à savoir Ökonomie und Klassenstruktur des deutschen Faschismus – Économie et structure de classe du fascisme allemand. Toutefois, dans des circonstances qui ne sont pas claires, en tout cas ne sont pas claires pour moi, le bon à tirer est envoyé à l’impression sans l’autorisation de Sohn-Rethel. Ce qui n’empêche pas la publication du livre, ni un certain nombre de traductions en langue étrangère, notamment en anglais et en italien, qui se font aussitôt. La version du manuscrit qui est ici publiée n’est donc pas celle des années 70, mais la traduction de l’édition critique inclue dans les œuvres complètes qu’un éditeur allemand, Ça Ira Verlag de Fribourg, a publié, et qui présente quelques différences (pas très grandes, disons des différences minimales) et un titre différent : Industrie et national-socialisme, en lieu d’Économie et structure de classe du fascisme allemand.
Il me semble que ce livre ne peut pas et n’a pas vocation à remplacer la lecture des classiques marxistes d’analyse de la société allemande sous le national-socialisme. Classiques dont je mentionnerai Behemoth de Franz Neumann, auquel Sohn-Rethel fait référence dans ce livre, et qui a le mérite de prendre la thèse du totalitarisme nazi et de la retourner, en montrant la pluralité des centres de pouvoir qui existent sous le national-socialisme, centres de pouvoir qui sont dans une forme de conflictualité permanente entre eux. J’ajouterai à ce classique de Franz Neumann, les travaux, malheureusement peu connus en France, de Timothy Mason sur la politique sociale du Troisième Reich.
Néanmoins, Industrie et national-socialisme permet, et c’est essentiel me semble-t-il, de recentrer les débats actuels autour des tendances contemporaines qu’on peut qualifier de fascisantes ou pas – à mon avis, non, mais ça c’est une autre question. Et donc de recentrer ces débats autour de la politique économique, de la politique étrangère et de la politique de gestion de la main-d’œuvre. Pour cette raison, il me semble qu’il faut saluer cette initiative des éditions La Tempête qui nous permettent enfin de lire ce livre qui, dans certains pays, a été traduit il y a 50 ans.
Romaric Godin
[Ce livre est] une analyse véritablement matérialiste d’abord de la montée du nazisme, mais aussi des politiques menées par le nazisme jusqu’en 1938 – puisque le texte s’arrête à ce moment-là. Il s’arrête à ce moment-là, mais il nous permet de comprendre ce qui vient ensuite.
En prenant un peu d’avance sur ce qu’on va dire plus tard, je trouve que c’est un peu ce qui manque aujourd’hui, précisément ce genre d’analyses très matérialistes, qui prennent effectivement les rapports de force au sein du capital, entre le capital et le travail, et regardent comment tout ça peut expliquer les évolutions politiques et sociales qui en découlent. Et ça, c’est fait vraiment dans ce livre de façon très précise, et avec la connaissance qui est la sienne, connaissance comme Robert l’a dit, de l’intérieur. C’est une histoire qu’on pense un peu tous connaître, parce que notamment quand on a une formation marxiste, on dit que la montée du national-socialisme, c’est le capital qui donne le pouvoir aux fascistes, et tout ça. Bon, en fait, c’est beaucoup plus compliqué que ça, et c’est vraiment une relecture de ces années qui vont de 1931 à 1938, qui est, à mon avis, vraiment très utile, donc je salue, moi aussi, la publication de ce livre par les éditions La Tempête.
Bon, ceci étant dit, de quoi s’agit-il, alors ? Ce qui est très intéressant dans ce livre, c’est son point de départ. Le point de départ, évidemment, c’est la crise du capitalisme. Alors, c’est un livre qui est vraiment centré sur l’Allemagne. On ne parle pas de crise du capitalisme mondial, même si, évidemment, ça apparaît à un certain moment clé, j’y reviendrai, et c’est vraiment une analyse nationale de la situation. Mais effectivement, on a une crise profonde du capitalisme, structurelle, dit Sohn-Rethel. En fait, évidemment, en 1929, etc., c’est le moment de, on va dire, de l’exacerbation de cette crise. Mais Sohn-Rethel montre bien que cette crise a, et c’est pour ça qu’elle est structurelle, une dimension plus profonde qui remonte à bien avant. Il explique que les éléments de cette crise sont déjà présents dans l’Allemagne impériale. Mais, ce qui est assez intéressant, c’est de montrer effectivement que la crise, elle-même ouvre une rupture au sein du capitalisme allemand entre deux grands camps : ce qu’il appelle, d’un côté, le camp de Brüning3Heinrich Brüning (1885-1870) est le chef de file du parti centriste allemand de la fin des années 1920 au début des années 1930. Chancelier du Reich de 1930 à 1932 juste avant von Papen, il est à la tête d’un gouvernement minoritaire qui sera contraint à la démission après la tentative de dissolution des SA. Il fuit l’Allemagne en 1934 et se réfugie aux États-Unis. et, de l’autre côté, le camp du front de Harzburg.
Le front de Harzburg, donc, est l’alliance entre les conservateurs et les nazis de septembre 1930. Cette division est extrêmement intéressante parce que, d’un côté, on a, on va dire, la partie saine du capitalisme allemand, celle qui continue à pouvoir exporter et à pouvoir être rentable selon le schéma classique de la création de plus-value et notamment, c’est un élément important, grâce à la plus-value relative, c’est-à-dire grâce aux gains de productivité. Donc, ça, c’est une partie qui devient, après 1929, extrêmement faible dans le capitalisme allemand mais qui l’est déjà dès les années 1920. Et l’autre partie du capitalisme allemand qui est une partie que Sohn-Rethel qualifie de déficiente, qui n’est plus rentable, qui ne fonctionne plus et qui ne peut plus vivre selon le schéma classique – on produit des marchandises, on les vend sur un marché, et on gagne de la plus-value.
Cette scission au sein du capitalisme se traduit politiquement par un alignement de la partie « saine » du capitalisme allemand – saine entre guillemets, car il n’y a pas de partie saine dans le capitalisme, disons saine du point de vue du capitalisme allemand – qui se rallie à la politique de Brüning, donc à la politique d’austérité, qui essaie par la réduction des dépenses publiques et le maintien d’un mark fort, de soutenir la partie rentable de l’économie allemande. Et puis, à côté de ça, il y a toute la partie de l’économie allemande qui n’est plus rentable. Alors, dans cette partie, qu’est-ce qu’il y a ?
Il y a, à la fois les vieilles industries, les industries qui étaient à l’origine du premier boom économique allemand dans les années 1860-1870, les industries de la première révolution industrielle. C’est-à-dire la métallurgie, la sidérurgie, le charbon, et puis qui sont, en fait maintenant dépassées par ceux de la deuxième révolution industrielle notamment les industries électriques – AEG, Siemens, etc. Donc ça, c’est la première, les grandes industries qui sont encore très importantes en Allemagne à ce moment-là mais qui ne sont plus rentables sur le marché mondial, et puis toute la partie, on va dire plus centrée sur la demande intérieure sur le marché intérieur allemand notamment le commerce, l’agriculture… Et effectivement, avec la crise de 1929 toute cette partie-là n’est plus du tout efficiente.
Ce que je trouve assez fort dans ce livre, c’est qu’il explique que le capitalisme, confronté à cette scission, ne peut pas, en réalité, s’appuyer comme tente de le faire Brüning, sur la partie saine, parce qu’elle est trop faible. Elle ne peut pas supporter l’intégralité de l’économie allemande, et donc miser uniquement sur la partie exportatrice et rentable de l’économie allemande entre 1930 et 1932, ça accroît la crise de la partie non rentable, parce que ça demande des efforts en termes de demande intérieure et de compétitivité pour les entreprises des secteurs en difficulté qui sont intenables. C’est donc une stratégie qui est quasiment suicidaire pour le capitalisme allemand. Mais quelqu’un comme Brüning ne peut pas s’appuyer sur la partie déficiente du capitalisme allemand, parce que ça ne fait pas de bonnes politiques économiques.
Donc, on se retrouve dans une sorte d’impasse. Et ce qu’explique Sohn-Rethel, c’est que le nazisme propose une issue à l’économie allemande. Cette issue, c’est d’établir un capitalisme qui est fondé sur sa déficience, qui fonctionne sur sa déficience. Sohn-Rethel a un mot extrêmement intéressant, que je trouve très parlant notamment pour aujourd’hui : à l’époque, évidemment, toute la gauche allemande savait que l’économie allemande était en ruine ; mais ce qu’elle ne savait pas, c’est que le capitalisme était capable de gérer cette ruine et d’organiser une économie qui était fondée sur le fait qu’elle était elle-même en ruine. Donc, en fait c’est la gestion rationalisée d’une économie de ruine qui se met en place, qu’il appelle aussi économie d’un capitalisme déficient. Et ça, effectivement c’est quelque chose qui permet de rétablir une forme d’unité dans le capital – même si, évidemment, c’est beaucoup plus complexe. Globalement, ça permet de sauvegarder par la dépense publique la partie déficiente du capitalisme, et donc tous les emplois et toute l’accumulation qui va avec cette partie déficiente. Et, en même temps, ça va offrir un débouché intérieur à la partie saine qui va venir s’intégrer, parce que, de toute façon elle est trop faible pour tenir d’elle-même l’économie allemande, à cette économie déficiente. D’une certaine façon, c’est une fuite en avant, ça c’est clair, mais c’est aussi une porte de sortie à la crise que proposent les nazis – ce que Sohn-Rethel appelle le fascisme allemand.
Cette porte de sortie, concrètement, c’est quoi ? C’est l’économie de guerre. Je ne m’avance pas sur ce qui va se passer et sur les échos que ça a aujourd’hui, mais cette idée d’économie de guerre, c’est précisément l’idée de produire du non-productif ; c’est-à-dire, et Sohn-Rethel insiste beaucoup là-dessus, de limiter et de centrer la fonction de la production uniquement sur la production elle-même, et non pas sur la production de plus-value qui, elle, va être organisée autrement – notamment par le fait que l’État va prendre en charge cette plus-value.
Et donc se met en place un système autour de cette économie de guerre, où on va pouvoir passer de ce qui fait la dynamique du capitalisme en temps normal, qui est la plus-value relative, c’est-à-dire les gains de productivité, à la plus-value absolue, c’est-à dire l’augmentation de la journée de travail et l’abaissement du salaire réel, soit faire travailler plus les gens pour moins.
Cette économie de guerre va permettre de rétablir dans cette partie déficiente de l’économie le taux de profit et l’accumulation. En tout cas, dans sa première phase de 1933-1934 : Sohn-Rethel raconte notamment comment Hitler va devant la Reichswehr, l’armée allemande de l’époque, pour leur dire : « vous m’avez demandé 25 milliards de marks d’investissement, je ne peux pas, tout ce que je peux faire, c’est 50 milliards. » Là, évidemment, il obtient l’adhésion de l’armée et c’est aussi comme ça qu’il rétablit le taux de profit. Et comme ce taux de profit, comme cette logique du capital qui est centré uniquement sur la production comme fin en soi, devient le mode de fonctionnement de toute l’économie allemande, la partie saine doit s’intégrer dans cette économie, c’est-à-dire que les entreprises qui fonctionnaient – type Siemens, AEG, etc. – ne sont plus destinées à l’exportation, mais sont intégrées à cette économie de guerre. L’économie de guerre devient la seule économie exportatrice de l’Allemagne, quasiment la seule.
Il faut aussi s’assurer, évidemment, de disposer des ressources nécessaires à cette économie de guerre. Et les ressources nécessaires à cette économie de guerre, c’est précisément, en tout cas dans un premier temps, la création de ce réseau centre-européen qui permet d’aller chercher le pétrole en Roumanie, les financements ici, les matières premières là. Et qui permet, jusqu’en 1938, de créer cette économie intégrée de guerre.
Et puis arrive 1938 : là, on arrive aux limites de cette histoire. Sohn-Rethel ne le raconte pas, mais dans Le Salaire de la destruction, son livre sur l’économie nazie, Tooze raconte que fin 1938 il y a un débat au sein du régime nazi entre, notamment, Hjalmar Schacht et Göring, pour savoir comment doit désormais s’organiser l’économie allemande. En fait, là, l’Allemagne arrive au bout de ses ressources. Elle n’a plus de ressources en termes de matières premières, parce qu’elle vit sur un système extrêmement limité (l’Europe centrale, a des ressources assez limitées pour assurer cette production). Et puis, surtout, elle manque de devises, parce qu’elle n’a plus cette force exportatrice qu’elle avait avant la Première Guerre mondiale, qui était fondée sur une industrie de biens de consommation principalement, et aussi un peu de biens d’investissement.
Et donc à ce moment-là se pose ce défi : c’est-à-dire, est-ce qu’on revient en arrière et qu’on relance la machine pour exporter des biens de consommation, des biens d’investissement à l’étranger, et donc on casse l’économie de guerre ? C’est-à-dire, est-ce qu’on décide de refaire de l’économie civile pour récupérer des devises et stabiliser l’économie, ou bien est-ce qu’on se lance dans une fuite en avant dans cette économie de guerre, en faisant ce qu’on peut ? Mais à ce moment-là, ça suppose quelque chose de très concret : il faut récupérer des matières premières, de la main-d’œuvre et de l’argent à l’étranger. Et donc, à ce moment-là, à l’étranger, ça veut dire en faisant la guerre : ça veut dire qu’on remplace la partie exportation sur le marché par la partie prédation. Or, ça tombe bien, puisque pendant cinq ans, l’Allemagne a produit principalement des outils de destruction, des outils de guerre. Et donc le choix qui est fait consciemment par Hitler à la fin de 1938 (qui est un peu décrit par Sohn-Rethel, mais évidemment il n’a pas cet élément-là, puisqu’il a quitté déjà l’Allemagne), choix conscient qui va déterminer l’occupation d’abord de la Bohème-Moravie en mars 1939, puis l’attaque contre la Pologne en septembre 1939, c’est celui de se lancer dans la fuite en avant, de ne pas revenir en arrière – Schacht s’éloigne à ce moment-là du régime.
La fuite en avant suppose la guerre. Alors évidemment, Hitler pensait que la guerre était inévitable, il n’était de toute manière pas question de revenir en arrière. Mais on voit bien, en lisant le livre de Sohn-Rethel, ce qui apparaît moins clairement dans celui de Tooze, que c’est la logique du nouveau capitalisme allemand qui est à l’œuvre et qui amène la guerre mondiale.
Il y a deux questions importantes qui sont soulevées par ce livre. La première, qui est liée à la deuxième, me vient de ce que dit Grossman. Grossman publie La Loi de l’accumulation et l’effondrement du système capitaliste, étant également une théorie des crises en 1929. C’est une lecture de la crise de suraccumulation du capital, et même si le titre parle d’‘‘effondrement du système capitaliste”, Grossman met bien en garde sur le fait qu’il n’y a jamais de situation désespérée pour le capital. Le fait que le capitalisme ait une tendance à l’effondrement n’entraîne pas le fait qu’il suffirait de s’asseoir et d’attendre pour le voir s’effondrer. Et ce que nous montre Sohn-Rethel, de façon très concrète, c’est la gestion de cet effondrement par le capital lui-même. C’est-à-dire que le capitalisme a les moyens de tenir ce que Sohn-Rethel appelle un « capitalisme de sous-équilibre ». Il y a, même dans la pensée économique mainstream complètement non-marxiste, une pensée de l’équilibre sous-optimal, du sous-équilibre. Sohn-Rethel nous dit que le fascisme allemand est un moyen d’organiser un capitalisme déficient (c’est-à-dire un capitalisme où le marché ne permet plus la création de plus-value) et donc de continuer à créer quelque chose qui est toujours du capital – ce qui est le but du capitalisme. Le but, c’est toujours l’accumulation c’est toujours l’exploitation mais ça se fait en dehors du schéma classique de l’échange, etc.
Il y a un débat actuel, notamment chez les marxistes, pour déterminer si l’échange est structurel dans le capitalisme ou non, ou alors est-ce que la production l’est, en gros – on peut penser aux débats entre Heinrich et Moseley, où on a l’idée qu’il peut y avoir une gestion du capitalisme où l’échange est secondaire, n’est pas central, et où on fait de la plus-value sans échange. Alors, évidemment, c’est extrêmement instable, c’est autoritaire, c’est dictatorial, et ça s’appelle le fascisme. Et c’est par cette gestion que Debord qualifie le fascisme, la gestion d’état d’urgence du capitalisme ; c’est aussi ce que décrit, par le menu et dans le détail, Sohn-Rethel.
C’était un peu la deuxième idée que je voulais mettre en avant : il pouvait y avoir un capitalisme qui n’avait pas la forme à laquelle nous avons été habitués depuis, avec l’émergence du néolibéralisme, c’est-à-dire un capitalisme où le marché est central. En fait, il existe des formes de capitalisme où le marché peut se mettre en éclipse. Mais, à ce moment-là, ça suppose des gestions autoritaires, notamment des gestions autoritaires de la main-d’œuvre. A la lecture de ce livre, on comprend la politique nazie, on comprend pourquoi il y avait des camps de travail et des camps de concentration : il fallait avoir de la main-d’œuvre gratuite, parce que le capitalisme nazi est fondé sur la plus-value absolue et que vous connaissez le mot de Marx : le problème de la plus-value absolue, c’est que les journées ont 24 heures. Et donc il faut faire travailler les gens jusqu’à l’épuisement. Et comme c’est un peu compliqué de faire travailler les bons Allemands de race supérieure jusqu’à l’épuisement, même s’ils le font aussi, on crée des camps de travail et on fait travailler les gens des zones occupées jusqu’à l’épuisement. C’est aussi quelque chose que Grossman met en avant lorsqu’il parle de ce capitalisme d’effondrement. Il dit que s’il n’y a pas de réponse par la lutte de classe à cette tendance à l’effondrement, on a effectivement une augmentation de l’exploitation. Et on ne peut avoir que ça, puisque la plus-value relative et les gains de productivités ne sont plus opérants pour faire augmenter le taux de profit.
Un dernier point, sur cette notion de classe. Pourquoi, dans ce cadre-là, puisqu’on a ce qu’on vient de développer, pourquoi n’a-t-on pas de réponse en face ? Ce n’est pas le thème central de Sohn-Rethel, mais il en parle un peu, notamment dans sa critique du Parti Communiste Allemand et de la stratégie que celui-ci met en œuvre à ce moment-là. C’est une stratégie qui est à la fois copiée sur le nazisme, qui est un peu le miroir de celle du Parti nazi, et qui en même temps est très électoraliste. D’une certaine façon, il n’y a pas de confrontation directe des masses laborieuses qui ne sont absolument pas nazies – ce qui est quelque chose qu’on sait maintenant, qui est très bien documenté, et sur lequel Sohn-Rethel insiste. Il dit que si vous aviez demandé à un ouvrier, y compris après l’arrivée du nazisme au pouvoir, s’il était nazi, il aurait trouvé un moyen de vous dire qu’il ne l’était pas – pas directement parce qu’évidemment dans ces cas-là, on fait attention. Effectivement, les masses ouvrières ne sont pas nazies ; et en même temps, elles n’ont pas bougé au moment où ce nazisme se met en place – ce qui s’explique en partie par le fait que la stratégie de la gauche, à ce moment-là, n’était pas adaptée.
La Tempête
Peut-être, Robert, peux-tu ajouter quelques mots. L’idée qui me semble centrale, que Romaric a déjà articulée, c’est que pour comprendre le fascisme, ce qu’il faut faire, c’est comprendre les contradictions entre les tendances internes à la bourgeoisie elle-même. On ne peut pas saisir le fascisme si on ne saisit pas les tendances concurrentes au sein de la bourgeoisie : le fascisme comme une solution à ces luttes internes à la bourgeoisie elle-même.
Cependant, une chose dont Romaric n’a pas parlé, et dont tu pourrais parler davantage, c’est quand même, notamment, les fondements de l’opposition relative de la bourgeoisie au fascisme : Sohn-Rethel en décrit quelques-uns. Et puis aussi la manière dont le capital gère l’excès de crédit (présent dans le fascisme allemand), l’importance et la place du crédit, et, on pourrait dire, de la dette, dans le fascisme.
Robert Ferro
Je voudrais d’abord revenir sur quelques points évoqués par Romaric, que je vais essayer de lier à ce que je disais tout à l’heure, c’est-à-dire les quelques thèses caractéristiques que Sohn-Rethel n’a fait que retravailler, approfondir, tout au long de sa trajectoire. On entend souvent, qu’il y a des auteurs qui écrivent à chaque fois un livre différent, et il y a ceux qui réécrivent toute leur vie le même livre. Je ne dirais pas que Sohn-Rethel a toujours réécrit le même livre, mais, disons qu’il y a ces thèses caractéristiques auxquelles il se réfère en permanence. Et une des thèses caractéristiques que je voulais mentionner, c’est le fait que la production du capitalisme moderne qui se développe, au XXe siècle – qu’à une époque on aurait définie comme néo-capitaliste, qu’aujourd’hui on pourrait définir comme fordiste, quelque chose de cet ordre-là, la grande usine organisée autour de la chaîne de montage et de la production continue – pour Sohn-Rethel (que ça nous plaise ou non, moi, personnellement, je ne suis pas d’accord), par les contraintes techniques qu’elle implique, contient déjà des éléments de dépassement du capitalisme. Et en ce sens, dans le livre de Sohn-Rethel qu’on présente ici, il y a des passages où il est très clair, à mon avis, que le national-socialisme, dans toute son aberration ou ses aberrations, est lui-même une forme, disons, post-capitaliste, ou qui ne respecte pas tous les critères qui font le capitalisme, qui permettent de délimiter les formes sociales capitalistes.
Ce n’est pas sans lien avec la question du crédit et de l’excès de crédit. Et ce n’est pas non plus délié de certains débats contemporains de la théorie économique, comme ceux qui tournent autour de ce qu’on appelle Théorie Monétaire Moderne, la MMT, c’est-à-dire cette tendance de la théorie économique américaine selon laquelle il suffirait d’imprimer de la monnaie pour non seulement relancer l’économie, mais la faire tourner à plein régime, résorber le chômage, et ainsi de suite. Par certains aspects, on peut dire, en forçant un tout petit peu le trait, que sur la base de l’analyse de Sohn-Rethel, le national-socialisme serait un exemple d’une économie qui fonctionnerait de cette manière, c’est-à-dire en imprimant de la monnaie ou en mettant à disposition des entreprises des capacités de crédit illimitées qui font tourner les capacités de production à plein régime, sans limite. Si on se réfère aux termes marxistes classiques, ça voudrait dire, ou ça pourrait vouloir dire qu’il n’y a plus de contraintes exercées par les rapports de production sur le développement des forces productives.
Problème : ce fonctionnement est circonscrit à une zone géographique donnée. Et à partir du moment où on enlève sur une zone géographique donnée les contraintes qui pèsent de façon ordinaire sur la production capitaliste en vertu de ces rapports de production, l’économie qui se développe au sein de ce périmètre rencontre immédiatement les limites qui viennent de son expansion. C’est ce que Romaric disait tout à l’heure : besoin de matières premières, parce qu’il n’y en a plus ou qu’elles sont difficiles d’accès, manque de travailleurs, et ainsi de suite.
C’est ce qu’on obtient par l’économie, en quelque sorte l’économie de guerre, unie à cette capacité presque illimitée de crédit que le national-socialisme met en place à travers ce qu’on appelle les bons MEFO, qui sont en fait une création de Schacht. Hjalmar Schacht met en place une société fictive qui s’appelle Metallurgische Forschungsgesellschaft, Société de recherche pour la métallurgie. Cette société fictive va émettre des obligations, privées donc, qui vont circuler et que les entreprises allemandes, celles qui travaillent pour la production militaire mais aussi les autres, utilisent pour se payer les unes les autres. Comme si, et ça encore une fois c’est Sohn-Rethel qui pose la question dans ces termes, comme si le remboursement de cette énorme masse de ce que Marx appellerait le capital fictif était subordonnée dans sa réalisation, dans sa concrétisation, dans son devenir de capital fictif à capital réel, à la victoire militaire.
Ensuite, une autre thèse caractéristique, qui existe chez d’autres auteurs mais qui, à mon avis, n’existe de façon si précoce que chez Sohn-Rethel, c’est la distinction entre ce qu’il appelle valeur reproductive et valeur non-reproductive – il faudrait peut-être dire marchandises productives et marchandises improductives ou quelque chose de cet ordre. Il range, en gros, la production militaire dans le travail improductif. Pourquoi ? C’est en fait une dérivation de passages qu’on trouve dans Le Capital de Marx, à savoir le fait que tout ce qui relève de la production militaire ne se retransforme pas en facteur du capital, c’est-à-dire ne se retransforme pas en marchandises qui rentrent dans le panier de consommation des masses laborieuses, ne se retransforme pas non plus en moyens de production qui, couplés à l’activation de la force de travail, vont produire plus de valeur, plus de plus-value. La production militaire correspond en fait à une stérilisation de valeur, à une stérilisation d’une partie de la plus-value et, dans les conditions qui sont décrites dans ce livre, à une stérilisation d’une masse croissante de richesses produites.
Dernier point que je tenais à évoquer : il y a dans ce livre des développements qui sont très intéressants sur l’organisation du marché agricole allemand par un organisme qui s’appelait le Reichsnährstand – qu’on pourrait traduire État nourricier du Reich. Celui-ci est censé s’occuper de quelque chose qui peut nous paraître relativement banal, mais qui à l’époque ne l’était pas du tout : l’organisation d’un marché agricole constitué par des petits producteurs. Or, cette idée, avec des différences quand même sensibles en particulier dans son caractère productiviste, est reprise après la guerre par l’organisation du marché agricole commun par l’Europe des Six – avec une différence quand même sensible qui était que dans l’Europe des Six, on voulait faire en sorte qu’il y ait un écrémage des couches les plus appauvries et des paysans les plus petits, avec une concentration relative du secteur agricole. Mais il y a toujours cette idée, cette idée nouvelle qui, à ma connaissance, a été introduite par le national-socialisme, de planification d’un marché de petits producteurs. Idée, donc, qu’il a été possible de réaliser dans le cadre de l’Europe des Six par un tarif protecteur et par le contrôle des prix. Ce système-là a été grosso-modo éliminé en 1992, d’où, à l’époque, des manifestations des agriculteurs en France et ailleurs contre le démantèlement du marché agricole commun tel qu’il était structuré alors.
Je voulais revenir très brièvement sur ce que Romaric a dit au sujet de Grossman. Je ne suis pas en total désaccord avec ce qu’il dit ; néanmoins, cet effondrement du capitalisme tel qu’on peut l’entendre sur la base de travaux type Grossman ou autres auteurs, c’est quand même un effondrement, fut-il géré par les moyens qu’on vient d’évoquer, sur un périmètre circonscrit. Si on ne se rappelle pas de ça, on tombe dans l’erreur stagnationniste qui est toujours la même depuis Trotsky et le Programme de transition de 1938 – c’est-à-dire penser que le capitalisme cesse de se développer. C’était ça la thèse de Trotsky de cette époque : le capitalisme a cessé de développer les forces productives. Or, à l’époque, il y avait quand même le New Deal aux États-Unis, pour ne prendre que le pôle capitaliste qui se développait le plus fortement. Et bien que le capitalisme américain ait été très fortement touché en 1929, et encore en 1936-1937 où la production industrielle américaine s’effondre de près de 50 %, celui-ci continue de croitre. Ça aussi il faut le garder à l’esprit lorsqu’on considère l’actualité.
Romaric Godin
Ce qu’il faut voir quand même c’est que dans les années 1930, le développement du capitalisme et sa reprise après la Seconde Guerre mondiale se fait dans le cadre d’un capitalisme d’état. Aux États-Unis c’est une reprise en main du capital par l’État qui est unique dans l’histoire de ce pays ; le cas du fascisme, on vient d’en parler ; on va parler évidemment du capitalisme d’État soviétique, dans lequel il y a aussi d’une certaine façon de la production pour la production. Et tout ça se résume dans la Seconde Guerre mondiale : cette fuite en avant pour la sauvegarde du capitalisme se termine dans la Seconde Guerre mondiale, et c’est la Seconde Guerre mondiale qui permet d’organiser la reprise et la croissance qui va être celle qu’on va connaître jusque dans les années 1970.
Donc si on regarde sur une durée longue, on ne va pas dire que le capitalisme a cessé de développer les forces productives, mais il les a développées d’une certaine façon, il les a développées parce qu’une fois que ce capitalisme d’État, notamment à l’Ouest, commence à rentrer en crise dans les années 1970, c’est la fuite en avant que tu décrivais – pas la fuite en avant de la MMT, celle du crédit. Entre 1970 et aujourd’hui, la dette mondiale a été multipliée par 20 : c’est ce qui a fait la croissance du capital depuis la crise des années 1970. Et cette croissance-là, est-ce que c’est le développement des forces productives ? Moi, je ne sais pas ; en tout cas c’est une forme de développement des forces productives qui fonctionne comme une fuite en avant permanente. Et aujourd’hui on voit bien qu’il faut que l’État revienne pour sauvegarder ce qui doit être sauvé. Donc il y a quand même quelque chose qui se joue dans les années 1930, qui est complexe et ne va pas être résumé facilement en quelques mots. Ce qu’apporte ce livre c’est l’idée que le capitalisme ne disparaît pas parce qu’il est en crise, d’une part, et d’autre part les formes de la croissance capitaliste peuvent être complexes.
Ça permet de répondre à une autre de tes remarques sur la question de la dette et du crédit : effectivement, c’est quelque chose qui est central, mais ce que dit très clairement Sohn-Rethel, c’est qu’il y avait des zones du capitalisme allemand qui étaient très opposées au nazisme, pour des raisons matérielles et concrètes, mais aussi pour des raisons morales. Mais ça n’a jamais débouché, en tout cas jusqu’à l’attentat de 1944, sur aucune révolte contre le nazisme. Et Sohn-Rethel dit très bien pourquoi : cette fuite en avant du crédit et de la dette, ce n’était pas un choix du capital qui aurait alors eu plusieurs alternatives, c’était sa seule alternative. Tout retour en arrière, comme l’option que propose Schacht en 1938 de revenir à une économie concurrentielle et productive, ne fonctionne pas. Et elle fonctionne d’autant moins que 1938, c’est la crise aux États-Unis, le retour de la crise. Et cette crise de 1938 aux États-Unis, elle va être réglée comment ? Par le début de la fuite en avant aussi des États-Unis dans l’économie de guerre. L’économie des années 1930, elle ne fonctionne plus. Le capitalisme mondial des années 1930 ne fonctionne plus. Il n’y a pas d’alternative à ça. Donc, effectivement, c’est une fuite en avant qui est à la fois sinistre parce qu’elle débouche sur la guerre et absurde sur le plan économique lorsqu’on le regarde avec les yeux de la science économique. Mais c’est la seule alternative, la seule possibilité de maintenir le taux de profit et l’accumulation. Et donc, c’est pour ça que je continue à croire que c’est du capitalisme. C’est une forme de capitalisme qui survit. Et c’est son seul mode de survie : le seul que le capital a trouvé à ce moment-là.
La Tempête
Je pense que ça serait qu’on finisse en discutant de l’actualité de ce texte, pour savoir dans quelle mesure l’analyse de Sohn-Rethel nous permet de comprendre, ou pas, le présent. J’ai noté deux points sur lesquels je voudrais insister.
Le premier point, c’est que la transition vers le fascisme repose sur la victoire d’un camp de la bourgeoisie contre un autre : la victoire de la fraction déficitaire de la bourgeoisie contre la fraction concurrentielle. L’Allemagne entre dans un capitalisme qui est déficitaire à partir de 1933, et la nécessité du fascisme provient de ce qu’il permet une solidarité entre les deux fractions de la bourgeoisie afin de maintenir le capitalisme.
Le deuxième point, c’est que le fascisme, en passant à une plus-value absolue, permet de briser la baisse tendancielle du taux de profit, qui s’est effondré. Et c’est notamment quelque chose que remarque Sohn-Rethel : entre 1932, et 1936, le taux moyen du salaire net réel est d’environ 33 %, le temps de travail augmente de 15 % et l’intensité du travail, augmente de 20 à 25 %.
Robert Ferro
Je pense que ce que tu viens de dire, à savoir que le fascisme est le produit des maillons faibles du capitalisme allemand, est une thèse vraie. Elle est en tout cas à considérer aussi du point de vue du capitalisme mondial dans son articulation. Le fascisme s’est imposé dans un certain nombre de pays, dont les principaux, l’Italie et l’Allemagne, sont deux capitalismes qui, dans le cadre des capitalismes avancés de l’époque, ne se trouvent pas en meilleure forme – notamment après la guerre de 14-18 et après la crise de 29. Évidemment, l’histoire du fascisme italien est un peu différente : dans l’histoire du fascisme italien, il y a quand même un tournant qui est la crise de 29. Elle fait passer les politiques du fascisme italien d’une certaine forme de libéralisme austéritaire au fait que, effectivement, l’État doit prendre en charge la survie de l’économie, parce qu’il n’y a pas d’alternative. Et, en l’espèce, en Italie, les trois principaux instituts bancaires s’effondrent. Et ce sont ces banques qui, grosso modo, contrôlent les principales entreprises industrielles. Si on insiste sur cette idée que le fascisme ne s’impose pas dans les pays qui sont en meilleure forme d’un point de vue capitaliste, quand bien même il serait en crise, je pense qu’aujourd’hui, si on tient à voir des tendances fascistes ou fascisantes, ce n’est pas aux États-Unis, qu’il faut aller les chercher. Ça c’est ma vision des choses.
Ensuite, j’aurai un certain nombre d’arguments qui ne sont pas spécialement marxistes, mais plutôt, disons, d’analyse historique, si vous voulez, qui me font dire qu’aujourd’hui on est dans une situation qui présente, effectivement, des ressemblances avec les années 30, en particulier une certaine forme de fragmentation économique au niveau mondial, mais qui ne présente pas cette similitude-là avec les fascismes italiens, allemands, etc.
Romaric Godin
Sur ce point, je voulais d’abord rappeler une chose : l’histoire ne se reproduit jamais à l’identique. Il faut toujours réfléchir à la façon dont on interprète ce qu’il se passe dans les années 1930, en projetant ce qui pourrait se réaliser aujourd’hui dans des conditions qui sont celles du capitalisme contemporain, qui ne sont pas du tout celles de l’Allemagne d’alors. Il faut toujours avoir à l’esprit que, même s’il peut y avoir des retours de l’histoire, ils ne se font jamais à l’identique. Donc, effectivement, il n’y a pas de fascisme au sens de celui de 1933 de toute façon, par définition.
Deuxième chose : on peut quand même montrer les points de similitude qu’on a entre aujourd’hui et ce que raconte Sohn-Rethel. Aujourd’hui, on n’est pas dans la crise telle qu’elle est après 1929, c’est-à-dire qu’on n’est pas dans la récession. Pourquoi ? Parce que l’État est venu empêcher cette possibilité. Donc, on a des économies qui sont de plus en plus étatisées, y compris aux États-Unis. La croissance des États-Unis, dont tout le monde se rappelle, en fait ça n’est que de la subvention. De la subvention et de la rente.
Ce sont les deux points sur lesquels se réalise aujourd’hui la croissance états-unienne et la croissance mondiale du capitalisme. Donc, on a quand même une économie qui est affaiblie, avec des taux de croissance qui sont de plus en plus faibles et, surtout, le point important par rapport à ce que raconte Sohn-Rethel, des taux de gains de productivité qui sont de plus en plus faibles et qui, en ce qui concerne l’Europe, sont même passés en négatif dans certains pays depuis la crise sanitaire, notamment en France. C’est donc quelque chose d’assez important, et c’est ce que raconte Sohn-Rethel : à un moment, le capitalisme n’est plus capable d’avoir ce moteur qui est celui des gains de productivité relatifs. Il lui faut aller vers la plus-value absolue. Et la plus-value absolue, ça veut dire les chiffres que tu as rappelés, ce que nous dit notre président de la République à longueur de temps, travailler plus. Donc, il y a quelque chose, quand même, qui se joue là, qui est, à mon avis, important. Premier point.
Deuxième point, on a une division au sein du capital qui est extrêmement forte, aujourd’hui. C’est moins une division en deux camps comme la présente Sohn-Rethel – à mon avis la vision de Sohn-Rethel est déjà un peu simplifiée. Mais quand même : on a une division avec une partie qui dépend très fortement de l’État pour survivre, qui ne survivrait pas sans les aides d’État. On a des entreprises qu’on appelle zombies qui sont là depuis la crise de 2008. Et on a des entreprises qui sont considérées comme non-zombies parce qu’elles vont être rentables, mais qui ne sont rentables que parce qu’il y a un soutien direct et indirect de l’État. Donc ça, c’est une part énorme du capital. Et c’est notamment tout le capital commercial, de la vente de détails, les PME, les petits artisans, les petits commerçants, etc. Mais c’est aussi l’industrie, car l’industrie mondiale, aujourd’hui, est entrée dans une phase de surproduction, de guerre des prix, avec un centre chinois qui, lui-même, est menacé de déflation – enfin, qui n’est pas menacé, qui est en déflation. Déflation, ça veut dire surproduction. Aujourd’hui, lorsque vous êtes un industriel, si vous n’avez pas les aides d’État, ce n’est pas la peine : vous n’êtes pas rentable, ça ne marche pas. Et puis, à côté de ça, on a une partie de l’économie qui peut sembler saine mais qui, en fait, est une économie de rentes, principalement. Techno, finance, immobilier, ce genre de choses qui sont des économies et des secteurs de plus en plus détachés et de la concurrence et du marché, qui fonctionnent sur un système de semi-concurrence, de semi-marché, notamment par le système de la dépendance des consommateurs, système des abonnements, ce système-là. Mais pas seulement : il y a le système de private equity en finance. Ce sont des secteurs dans lesquels, avec souvent mais pas toujours la complicité de l’État, se développe un système qui essaye de contourner la réalisation de la plus-value par l’échange. Donc moi, ça me fait dire qu’on est dans un capitalisme qui est déficient.
Le taux de croissance faciale du capitalisme aujourd’hui – qui est déjà assez faible, à peu près 3 % au niveau mondial, et plutôt autour de 1 %, voire 0,5 % en Europe – prend en compte tous ces modes de contournement de la production de plus-value. On est donc dans quelque chose qui, à mon avis, fonctionne de moins en moins bien. Et c’est là où, encore une fois j’insiste là-dessus, ce que nous raconte Sohn-Rethel, c’est que ce n’est pas parce que ça ne fonctionne pas bien que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne, mais c’est une fuite en avant.
Fuite en avant aussi par la dette, on l’a raconté. Ça a commencé dans les années 70, mais ça s’est beaucoup accéléré après la crise de 2008. Dette publique et dette privée sont complémentaires. Et à un moment, la fuite en avant demande des résolutions. C’est la fameuse réunion de fin 38 dont je vous parlais. C’est-à-dire qu’à un moment, il faut soit continuer à faire de la cavalerie financière, soit il faut solder ces dettes-là : la croissance de la dette n’est pas en accord avec la croissance de l’économie. Ce capital fictif, il ne se réalisera jamais : il est impossible à réaliser. À un moment, effectivement, il faut qu’il y ait ce type de crise et de résolution. Et pour résoudre ces contradictions-là, il faut s’appuyer sur un État qui est de plus en plus autoritaire. Alors, est-ce que c’est du fascisme, du néofascisme, du post-fascisme, du je ne sais pas quoi, ça, je n’en sais rien. Pourquoi pas ? Enfin, moi, je suis ouvert à tout. On peut discuter des termes autant qu’on veut. Mais ce qui est certain, c’est – et c’est la leçon que je retiens de Sohn-Rethel – que lorsqu’on est dans ces situations où le capitalisme est déficient, la solution que trouve le capital pour conserver la main (pas conserver la main juste parce qu’ils veulent être au pouvoir, conserver la main pour conserver la logique d’accumulation), c’est, en réalité, d’avoir recours à des régimes autoritaires. Parce que c’est là aussi ce que dit Sohn-Rethel, il faut développer la plus-value absolue. Et que la plus-value absolue, ça suppose, en fait, de la répression sociale, de la destruction des hommes. Enfin, c’est l’augmentation, du taux d’exploitation. Et que ça, effectivement, ça suppose un mode politique qui est un mode autoritaire.
Membre du public
En quoi la réaction fasciste face à la crise du capitalisme diffère-t-elle, pour Sohn-Rethel, de la réponse impérialiste classique ? Parce que là, avec les différents paramètres dont vous avez parlé, il y a un blocage au niveau de l’extraction de la plus-value relative, donc il faut aller chercher de la main d’œuvre gratuite, des nouveaux marchés, de la matière première, l’économie qui se transforme en économie de guerre, pour les politiques expansionnistes, etc. En quoi est-ce qu’on n’a pas là tous les ingrédients de l’impérialisme, tel qu’il est déjà théorisé par Rosa Luxembourg ou Lénine, et qu’est-ce que Sohn-Rethel apporte de plus ?
Ça pose aussi la question de savoir si on a pas affaire à quelque chose qui est qui est présent dans la théorie décoloniale. Toscano en parle dans son bouquin4Alberto Toscano, Fascisme tardif, La Tempête, 2024., est-ce que ce n’est pas un petit peu un angle mort de la plupart des théories du fascisme, que de ne pas voir le fascisme comme une espèce de variante européenne de l’impérialisme, qui s’applique à des populations blanches, européennes, etc., qui est vu sous le prisme d’une certaine exceptionnalité, avec l’angle mort de la colonisation ?
Robert Ferro
Tu soulèves une question très vaste : il faudrait avoir le temps de rentrer dans le débat des théories de l’impérialisme. Tu as mentionné celles de Lénine et celles de Luxembourg, il y en a d’autres : mais nous n’avons pas le temps de rentrer dans ce degré de détail. Il me semble néanmoins important de bien distinguer colonialisme et impérialisme, en ce sens que l’impérialisme, tel qu’il a effectivement été théorisé par ces gens-là et par d’autres, n’implique pas une subordination politique directe. De plus, le colonialisme historique présuppose, pas forcément dans tous les cas, mais dans la majorité des cas, une implantation importante de populations qui viennent de la métropole.
Ensuite, je reviens à l’idée sur laquelle j’insistais tout à l’heure, c’est-à-dire le fascisme comme produit des maillons faibles du capitalisme à l’échelle internationale. C’est vrai aussi du point de vue de la possession de colonies, dans la mesure où l’Allemagne avait un certain nombre de colonies, un empire colonial, principalement africain – il y avait aussi quelques îles dans l’océan Pacifique, les Samoa allemandes : il y avait le Cameroun, la Namibie, le Togo,… Et cet empire colonial-là est perdu à l’issue de la guerre de 14-18. Le colonialisme italien, on ne peut pas dire que ça a été le colonialisme le plus conséquent qui ait existé dans l’histoire. Pour faire référence à un auteur anticolonialiste important, Aimé Césaire dit dans son Discours sur le colonialisme que le scandale d’Hitler, c’est d’avoir appliqué aux Blancs les mêmes politiques colonialistes et d’extermination qui ont été appliquées par les Blancs dans les colonies non-blanches. Cette analyse-là, on peut la faire, mais il faut quand même garder à l’esprit que ce sont justement ceux qui n’ont pas de colonies ou n’ont plus de colonies qui relancent un néocolonialisme. Dans le cas allemand, c’est un néocolonialisme classique en ce sens qu’il comporte cette dimension de l’installation d’une population autochtone avec le fameux Drang nach Osten [Poussée vers l’Est] qui comporte aussi le déplacement de populations allemandes pour aller coloniser ces zones occupées.
Romaric Godin
Je suis assez d’accord avec ce que Robert vient de dire, et je pense qu’il y a un élément important qui est que, pour moi, il ne faut pas les opposer. C’est-à-dire qu’effectivement, dans ce qui est resté de démocratie à ce moment-là, qui sont aussi des économies en crise, le Royaume-Uni et la France, c’est aussi des moments où il y a une reprise en main de l’empire colonial. Et notamment, le Royaume-Uni est sauvé par son empire colonial. C’est les accords d’Ottawa5Accords de 1932 entre le Royaume-Uni et les membres du Commonwealth mettant en place une configuration protectionniste avec l’effacement des barrières douanières au sein de l’union et l’augmentation de celle-ci pour les échanges extérieurs., la création du Commonwealth, ce bloc économique qui lui permet d’avoir des ressources bon marché et des marchés en retour.
Bon, la France est un peu particulière, mais en fait la France a quand même cette possibilité, et c’est pour ça que la crise arrive aussi un peu plus tard en France : elle a ce flux de capitaux qui viennent des colonies. En Allemagne, effectivement, à ce moment-là, ce n’est pas possible. L’Italie tente d’ailleurs, sous le fascisme, de développer son colonialisme, donc il n’y a pas de contradiction. Le fascisme italien est un fascisme colonialiste et impérialiste. Pour l’Allemagne, c’est un peu plus compliqué, et d’une certaine façon, c’est une citation qui est très juste, ils appliquent aux territoires qui les entourent les pratiques colonialistes des démocraties de l’époque pour des raisons économiques. Mais ce qui est intéressant aussi, c’est que cette recherche de la plus-value absolue touche aussi directement leur population. C’est aussi quelque chose d’extrêmement important : les puissances impérialistes pouvaient faire croire à leur population qu’ils les traitaient bien parce qu’effectivement, il y avait cette possibilité d’avoir des ressources par ailleurs. Dans le cas allemand, ce n’est pas possible. Dès 1933, il y a cette mise au pas – c’est le Front du Travail du 1er mai 1933 – du monde du travail allemand qui est très forte et est souvent sous-estimée. En fait, c’est un régime de terreur. Le moment de juin 1934 et de la répression des SA, c’est un deuxième moment de terreur. Toute la main-d’œuvre allemande est embrigadée, militarisée : effectivement, il y a aussi une pratique de cette forme de colonialisme sur la population allemande. Directement sur une partie de la population allemande qui sera à la fois emmenée dans des camps de travail pour tout ce qui est opposant, et exterminée dans le cas de la population juive. Ça rappelle les exterminations, évidemment, qui ont été initiées par l’Empire allemand en Namibie au début du 20e siècle. Il y a quand même des liens qui se font. Les camps de concentration ont été inventés par les Anglais pendant la guerre des Boers. Les camps d’extermination ont été inventés par les Allemands pendant la guerre coloniale de la Namibie. Et tout ça se retrouve dans le fascisme européen des années 30. Donc pour moi, c’est plutôt complémentaire avec des formes de réalisation particulières liées aux conditions qu’a rappelé Robert. Mais je pense qu’il n’y a pas de contradiction entre les deux. C’est complémentaire.
Membre du public
Pourquoi aux États-Unis, il n’y aurait pas un phénomène qu’on pourrait nommer fasciste ou fascisation aujourd’hui ?
Robert Ferro
C’est qu’en fait, les États-Unis dominent le monde. C’est tout simplement ça.
Et c’est une question qui à mon avis transcende ce qu’on peut trouver ou ne pas trouver dans Sohn-Rethel. De façon générale, moi je suis assez méfiant vis-à-vis de toutes les thèses qui prêtent, qui essayent de voir ou qui veulent voir dans tel ou tel capitalisme contemporain une tendance à la fascisation. Parce que pour moi le fascisme reste en quelque sorte circonscrit et lié aux conditions qui sont celles de l’après Première Guerre mondiale, de façon extrêmement banale et concrète.
J’ai énuméré quelques éléments, je vais les rappeler vraiment très rapidement. Le fascisme ne peut pas être dissocié du contexte de la première guerre mondiale et de ses suites dans la mesure où l’essentiel des bandes fascistes sont constituées d’anciens combattants qui vivent avec grande difficulté et malaise le retour à la vie civile. On ne peut pas balayer ça, c’est un fait politique énorme et essentiel, d’un revers de main. Se pose aussi bien dans le fascisme allemand et dans le fascisme italien la question du revanchisme néocolonial par des pays qui sont soit dépourvus de colonies soit les ont perdus. Pays qui se sont unifiés très tardivement tous les deux : 1870-1871 dans le cas de l’Allemagne, 1860 dans le cas de l’Italie. Ils ont encore pas mal de problèmes de différents territoriaux autour d’eux, ont aussi des minorités d’Italiens ethniques et d’Allemands ethniques, qui vivent en dehors de leur État respectif. Et là aussi, si on ne tient pas compte de ça on ne peut pas comprendre la politique étrangère du national-socialisme qui vise précisément à s’appuyer sur ces minorités allemandes qui vivent en République tchèque, en Roumanie, dans le Tirol du Sud, etc. et d’utiliser en fait ces minorités comme en quelque sorte des actifs géopolitiques. Pour ce qui est de l’Allemagne, elle est aussi séparée d’un de ses berceaux nationaux qui est la Prusse orientale. J’ai du mal à voir qu’est-ce qui peut ressembler à quelque chose de cet ordre là, c’est-à-dire de la conjonction de ces éléments ou de ces facteurs dans un contexte actuel. À la limite, je peux voir une dimension néo-coloniale ou néo-colonialiste dans l’Israël contemporain, mais l’Israël contemporain n’a pas du tout la taille d’un pays comme l’Allemagne. Là il y a peut-être la question à un niveau géopolitique de la taille minimale optimale pour effectivement mener ce type de projet.
Romaric Godin
Il ne faut pas fétichiser le terme de fascisme : évidemment on n’est pas en 1933 ni en 1921. Les frontières sont différentes, les peuples sont différents, le capitalisme est différent. Ce qu’il faut, c’est réfléchir au fait qu’il se passe quand même quelque chose en ce moment dans le cœur du capitalisme mondial, dans nos pays européens et dans les pays qui se sont développés depuis 20 ans, qui n’est pas le fascisme mis en place par Mussolini. Et donc si on ne veut pas appeler ça fascisme, appelons ça autrement, ce n’est pas grave. Ce qui me semble essentiel c’est de comprendre quand même ce qu’il se passe, cet élément réactionnaire, violent et autoritaire.
Robert Ferro
Sauf que les politiques économiques sont opposées. Les politiques économiques de Trump et de Milei sont opposées : l’un est protectionniste, l’autre est anti-protectionniste. Tu prends Meloni et tu prends d’autres gouvernements de droite en Europe, ce n’est pas du tout les mêmes politiques qui sont menées.